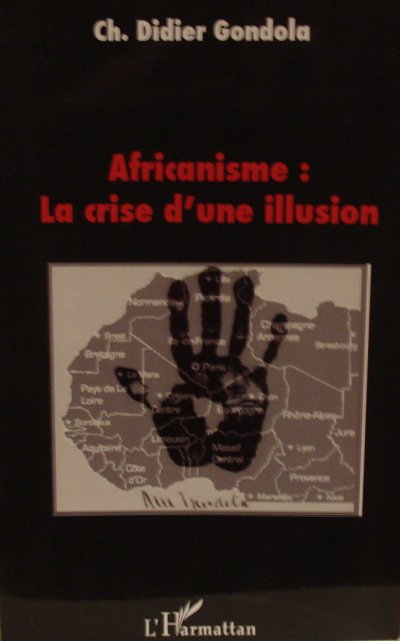 La négrophobie académique de l’africanisme (français) avait été déjà bien analysée par Cheikh Anta Diop, Marcel Amondji, Valérien Mudimbe, Mongo Béti, Théophile Obenga, Jean-Marc Ela, Stanislas Adotevi, et beaucoup d’autres auteurs africains. L’une des valeurs ajoutées de Didier Gondola, dans cette longue tradition de critiques des Africains contre l’africanisme, consiste en sa méticuleuse sociologie des acteurs et institutions africanistes français.
La négrophobie académique de l’africanisme (français) avait été déjà bien analysée par Cheikh Anta Diop, Marcel Amondji, Valérien Mudimbe, Mongo Béti, Théophile Obenga, Jean-Marc Ela, Stanislas Adotevi, et beaucoup d’autres auteurs africains. L’une des valeurs ajoutées de Didier Gondola, dans cette longue tradition de critiques des Africains contre l’africanisme, consiste en sa méticuleuse sociologie des acteurs et institutions africanistes français.
Cet auteur nous rappelle que ce n’est pas seulement le discours africaniste qui est viscéralement négrophobe ; ce sont d’abord et surtout les auteurs de ce discours qui sont racistes, profondément imbus de « la suprématie blanche[1] » sur les nations colonisées, esclavagisées, manifestant si rarement quelque sympathie pour leur objet d’étude (l’Afrique) qu’ils considèrent souvent de très haut, depuis leur piédestal de gens civilisés, de surcroît prétendument érudits.
A propos de la production de savoir académique, scientifique, des occidentaux sur l’Afrique, Cheikh Anta Diop avertissait déjà en 1954[2] :
[…] s’il faut en croire les ouvrages occidentaux, c’est en vain qu’on chercherait jusqu’au cœur de la forêt tropicale, une seule civilisation qui, en dernière analyse, serait l’œuvre de Nègres. […]Pourtant toutes ces théories “scientifiques” sur le passé africain sont éminemment conséquentes ; elles sont utilitaires, pragmatistes. La vérité, c’est ce qui sert, et, ici, ce qui sert le colonialisme : le but est d’arriver, en se couvrant du manteau de la science, à faire croire au Nègre qu’il n’a jamais été responsable de quoi que ce soit de valable, même pas de ce qui existe chez lui.
[…] L’usage de l’aliénation culturelle comme arme de domination est vieux comme le monde ; chaque fois qu’un peuple a conquis un autre, il l’a utilisée. […] On saisit le danger qu’il y a à s’instruire de notre passé, de notre société, de notre pensée, sans esprit critique, à travers les ouvrages occidentaux. […]
Compte tenu de ce qui précède, ces théories [occidentales sur l’Afrique] sont, ”a priori”, fausses, parce qu’elles ne cherchent pas à atteindre la vérité. Si quelqu’une d’entre elles se souciait de le faire, une éducation occidentale faussée depuis des générations la priverait de la force nécessaire pour y parvenir. Il devient donc indispensable que les Africains se penchent sur leur propre histoire et leur civilisation et étudient celles-ci pour mieux se connaître : arriver ainsi, par la véritable connaissance de leur passé, à rendre périmées, grotesques et désormais inoffensives ces armes culturelles.
D’où cette réticence du contact avec le terrain (en dehors des palaces et autres palais de dictateurs africains patronnés par leur pays), avec les gens africains tenus fermement à distance par une recherche essentiellement effectuées dans les archives (coloniales) françaises. Or, ces archives disent principalement le point de vue des colons, de l’administration coloniale, plutôt que celui des colonisés : c’est donc une perspective “colonialocentrée”, un discours hétérodoxe sur l’Afrique…
Didier Gondola insiste bien sur le fait qu’un tel discours a sa propre légitimité, et ne saurait être condamné a priori ; sauf qu’en l’occurrence il se prétend être LE discours par excellence sur l’Afrique, le seul possible/admissible, qui proteste sempiternellement de sa sacro-sainte scientificité, et dont les gourous ont vite fait de vilipender les rares auteurs africains qui travaillent à s’en émanciper : c’est donc l’hégémonie du discours africaniste sur l’Afrique, au moins autant que l’aridité dudit discours, que fustige Didier Gondola ; lequel considère que cette hégémonie est illusoire, car on ne saurait empêcher indéfiniment les Africains de parler eux-mêmes pour leur propre compte. A cet égard, la section intitulée “L’africanisme contre l’afrocentrisme” est particulièrement savoureuse :
[P.100]
Les africanistes ont tué dans l’oeuf le courant afrocentriste tant en France qu’en Afrique en brandissant le spectre du racisme, incarné, selon eux, par Cheikh Anta Diop. Ils ont, selon Ela, réduit au silence jusqu’au nom de l’auteur de Nations nègres et cultures (Ela 1989 : 57). Aujourd’hui ils continuent de tenir sous surveillance, voire censurer, toute parole non encadrée parmi les intellectuels africains. Mais voici qu’épouvantés par les vigoureux développements de l’afrocentrisme outre-atlantique, ils s’évertuent d’amorcer non pas un dialogue avec, mais un monologue institutionnel contre un courant auquel ils ont refusé au préalable non pas seulement le sceau de scientificité mais aussi le simple droit de cité dans les études africanistes.
[PP.135-136]
L’Amérique, on en dira tout le mal qu’on voudra, n’est pas frileuse, elle. Aujourd”hui ses universités ouvrent leurs portes à plusieurs jeunes historiens francophones d’Afrique qui y occupent des postes de Professor, Associate professor tandis que d’autres sont en voie de titularisation en tant que Assistant Professor. Pourquoi vouer l’Amérique aux gémonies alors que la France refuse d’incorporer ces chercheurs africains? Comment en même temps s’offusquer que l’amérique recrute ces chercheurs et leur barrer l’entrée dans les universités et les intitutions de recherche en france? Prenez le cas d’achille Mbembe, un chercheur apprécié par les africanistes, avec un talent énorme, il fautle reconnaître, même si, farouchement carriériste, il participe du discours afropessimiste du CAF. Mbembe a su cultiver des attaches solides au sein du CAF. Entre lui et le politologue Jean-François Bayart, par exemple, naquit très tôt, écrit-il dans son récit biographique, “une collaboration et un appui décisif et jamais démenti”. […]
Son entregent au sein du CAF et ses entrées dans les milieux académiques français ne l’aideront guère à trouver un poste dans une France, écrit-il, a posteriori, où “les perspectives pour un Africain de trouver un travail dans le système universitaire étaient négatives […]” Quitter cette France intolérante pour un historien africain de l’Afrique formé en France et qui n’aspire à autre chose qu’à apporter sa contribution à ce vaste champ de recherche est plus qu’un exil. On se sent littéralement , comme un boxeur en détresse et sans recours, bousculé, poussé dans les cordes, sans issue, sonné, K.O. C’est un échec personnel pour tous ceux qui contrairement à Mbembe ou à moi-même n’ont pas eu la bonne fortune de trouver un poste ailleurs. Mais c’est aussi une déréliction collective. On sent l’Afrique s’effriter sous nos pieds comme engloutie dans un gigantesque vortex, trahie, aphone, paralysée par l’énormité du crime auquel elle succombe.
Demandons-nous dans quel état se retrouvent ceux qui, comme des souris entre les griffes du chat, restent sous la botte des africanistes. Ceux qui restent sont réduits à une condition aiguë d’aphasie intellectuelle. Ne rien entendre, ne rien voir, ne rien dire, quand les africanistes sacrifient l’Afrique sur l’autel de l’érudition. Le chercheur africain en France souffre d’une sorte de schizophrénie inetllectuelle. A froce de jouer les béni-oui-oui, mais les coeurs remplis de frustration, nos jeunes chercheurs se retrouvent en déphasage avec la réalité, dans une impasse intellectuelle qui ne leur permet plus de se prononcer avec lucidité et sincérité sur les questions fondamentales de notre discipline.
Gondola rapporte, entre autres, qu’environ 3/4 des doctorants en études africaines des universités françaises sont des Africains (Continent + Diaspora, notamment antillaise). Pourtant, les nouveaux enseignants en Etudes Africaines sont recrutés quasi-exclusivement parmi le dernier quart de doctorants, à savoir les non-Nègres, plus précisément les Blancs : en France, la discrimination à l’embauche des Nègres serait encore plus sévère dans les universités et institutions de recherche que sur les chantiers clandestins de BTP. Comme les crédits de recherches sur le terrain africain sont de plus en plus rares, on se retrouve avec des enseignants blancs – des Africanistes – n’ayant quasiment jamais rencontré (de visu) leur objet d’étude, et qui se spécialisent dans l’étude des publications de leurs maîtres à penser, dont certains sont ainsi devenus de véritables gourous, au fil des décennies. Donc une connaissance (?) africaniste de l’Afrique devenue quasi-exclusivement livresque, puisée à des ouvrages parfois anciens (dépassés), d’une négrophobie épistémologique souvent “enragée”. Dans ce contexte de décrépitude scientifique, les 3/4 de doctorants africains servent comme des apporteurs de matériau. En effet, à l’occasion de leurs vacances en Afrique, ou grâce à leurs contacts familiaux avec le Contient-Mère, et des régions diasporiques, les doctorants africains-antillais irriguent leurs profs blancs d’informations « de terrain » : ils apportent de la matière à penser, mais sont subrepticement exclus des processus d’élaboration de la pensée africaniste.
L’un des points cruciaux relevés par Gondola consiste au fait qu’environ 80% des travaux scientifiques ayant l’Afrique pour objet sont réalisés hors du continent, par des non-Africains : notre patrie est le seul continent dans ce cas. En d’autres termes, les Africains sont ceux sur cette Terre qui ont le moins de connaissance scientifique d’eux-mêmes, de leur histoire, géographie, faune, flore, ressources énergétiques, démographie, santé, etc. Cette méconnaissance radicale de soi est l’une des plus grosses carences de l’Afrique, qui l’expose encore à tous les risques (naturels, économiques, militaires, stratégiques, etc.), dans une sorte d’impuissance collective, d’atonie généralisée, voire de cécité épistémologique.
Ainsi , au delà de l’illusion africaniste, il y a ce manque abyssal d’une connaissance de soi par les Africains, manque entretenu par ceux qui y ont le plus grand intérêt ; et surtout manque qui désormais s’auto-entretient. En effet, une belle brochette d’intellectuels africains (Ouologem, Axelle Kabou, Ka Mana, Gaston Kelman, etc.) participent depuis des décennies à ce dévoiement de soi, à travers une production bibliographique souvent inconséquente, superficielle, voire niaise ; production récupérée déréchef par les Africanistes et autres Afropessimistes professionnels (Stephen Smith, Fauvelle-Aymar, Jean Copans, etc.) qui la balancent à la face des Africains tentant de proposer un discours autonome. A ce propos, on peut signaler l’excellente contribution de Boubacar Boris Diop dans L’Afrique répond à Sarkozy [p.144] :
De façon moins élaborée, mais souvent mus par la même volonté de favoriser un électrochoc, les romanciers [africains] faisaient de leur côté, avec la démesure et les effets de dilatation que seule autorise la fiction, le procès des systèmes politiques postcoloniaux. Les uns et les autres avaient malheureusement tendance à confondre Etat africain et société africaine. Celle-ci était soupçonnée de couver, par le simple fait qu’elle restait elle-même, les germes de sa propre destruction, plusieurs fois annoncée à l’époque – puis aussitôt reportée sine die. C’était là l’exemple achevé d’une vision purement essentialiste de la réalité africaine, tournant autour d’elle même, comme le serpent qui se mord la queue, avec une lassante monotonie. Négligeant les rapports de force politiques réels et l’impact décisif de l’Etat français sur les luttes de pouvoir dans chaque pays de son ex-Empire d’Afrique subsaharienne, la réflexion se polarisait, avec une singulière obstination, sur les effets visibles du désatre au détriment de ses causes profondes, moins spectaculaires il est vrai. Cette littérature, en principe destinée aux Africains, a été en réalité beaucoup plus lue par les Occidentaux. Ceux-ci en ont fait leurs délices et elle leur a procuré un exquis sentiment d’innocence. Ces auteurs balisaient à leur insu la voie à une négrophobie que l’on voit chaque jour un peu plus paisible et décomplexée, mais qui sait être vulgaire et injurieuse à l’occasion. […] En France et dans le reste de l’Occident, des essayistes africanisants s’en sont largement servis pour donner une seconde vie aux préjugés les plus incongrus sur le continent.
Par ailleurs, les gourous africanistes sont souvent des universitaires médiocres auxquels leurs collègues des autres domaines de recherche auraient abandonné le terrain africain, tenu pour parent pauvre de la recherche universitaire française. Ce qui explique que l’on y trouve des nigauds à la manière d’un Bernard Lugan tenant une place exorbitante malgré leur imbécilité abyssale. Cela explique également la place particulièrement prépondérante qu’y tiennent des Français blancs d’origine étrangère ainsi que les femmes (Gourevitch, Sophia Mappa, Coquery-Vidrovitch, etc.), puisque la concurrence y est moins âpre entre Blancs, en raison du caractère peu prestigieux des perspectives de carrière, comparativement aux autres domaines de recherche universitaire.
On comprend alors pourquoi un jeune chercheur africain talentueux (autrefois Ama Mazama, puis désormais Didier Gondola, etc.) qui s’immisce dans un tel milieu de cancres universitaires blancs soit regardé comme une très grave menace des situations professionnelles et académiques usurpées. Sauf si (comme Achille Mbembe, Elykia Mbokolo?) ces talents africains parviennent à cultiver une docilité épistémologique compatible avec la négrophobie généralisée en africanisme. Pour sortir du carcan africaniste sclérosant, la recherche africaine doit se doter de ses propres moyens institutionnels, infrastructurels, constitués en Afrique pour l’Afrique et par les Africains ; avec notamment des revues scientifiques dignes de l’immense créativité épistémologique des chercheurs africains.
De ce point de vue, une coopération étroite et intensive avec des centres de recherches africains-américains et afro-brésiliens devrait être vivement recherchée par les autorités politiques africaines en charge des question d’Education Nationale : une illustre institution comme la HOWARD UNIVERSITY devrait être un exemple à reproduire dans nos pays, notamment en Côte d’Ivoire, avec des échanges massifs d’enseignants et d’étudiants, la traduction intensive des innombrables productions scientifiques intéressant l’Afrique qui ont été réalisées dans cette université depuis le XIXè siècle. On pourrait également imaginer une université construite à Grand-Bassam, dénommée Asante Kete Molefi et qui soit jumelée avec la TEMPLE UNIVERSITY, où a été créée la première chaire d’African-American Studies par le chantre de l’afrocentricity.
Par KLAH Popo
[1] Sophie Bessis, L’Occident et les autres, éd. La Découverte, 2001
[2] Cheikh Anta Diop, Nations nègres et culture, éd. Présence Africaine, Tome I, Préface de la première édition.

[…] les auteurs de ce discours qui sont racistes, profondément imbus de « la suprématie blanche[1] » sur les nations colonisées, esclavagisées, manifestant si rarement quelque sympathie pour […]